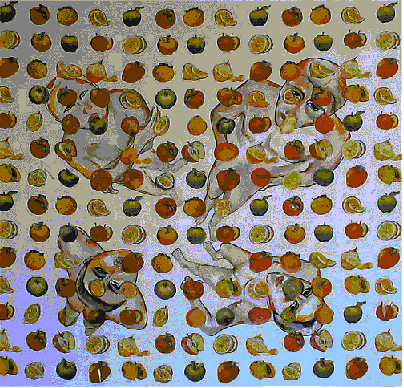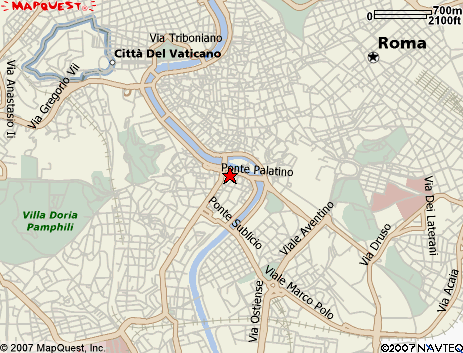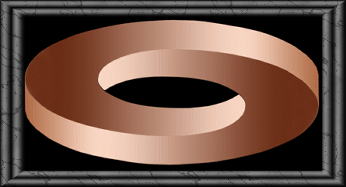Francis DESIDERIO fut de tout temps fasciné par la recherche archéologique de traces de civilisation. De mémoire, il fouille notre humanité pour mieux l’exprimer. Si Pompéi reste sa plus grande source d’inspiration, l’artiste se projette également dans un futur qui, un jour deviendra notre passé. Par son “travail” de création, l’artiste le restitue sous une forme tantôt picturale mais le plus souvent sculpturale dans ce qu’il conviendrait de qualifier “une forme d’archéologie du futur”.
Ainsi, ses tableaux de sable ou en relief et ses sculptures monumentales ou de salon restituent les fantasmes de l’esprit en entraînant le spectateur vers un rêve éveillé où se mélangent rigueur, force contrôlée d’expression, état d’âme, sensations diverses. Ses créations sont faites pour s’intégrer à toutes habitations modernes ou anciennes.
Il serait utopique de leur donner un âge ou un style défini dans la mesure où elles sont représentatives de strates d’humanité. Toujours est-il qu’il demeure impossible de rester indifférent face à des Å“uvres forçant à la méditation.
En une trentaine d’années de carrière, Francis DESIDERIO, a déjà à son actif une centaine d’expositions remarquables qui dépassent nos frontières et dont les noms incitent aussi au voyages et à la rêverie : Rome, Venise, Barcelone, Paris, Stockholm, Ottawa, Montréal, Toyamura, New York, …
Jean François Bélian
Maggio 2007
Gio 31 Mag 2007
Francis DESIDERIO président du Comité National AIAP UNESCO
Posted by Antonio Picariello under arte/teatro , ComunicazioneNo Comments
Mer 30 Mag 2007
NADER AHRIMAN .MATTHEW ANTEZZO JONAS MEKAS JONATHAN MONK JOSEPHINE PRYDE DAVID WOJNAROWICZ
Posted by Antonio Picariello under arte/teatro , ComunicazioneNo Comments
GIOVEDI’ 21 GIUGNO 2007 ORE 19.00
1/9 unosunove arte contemporanea
PRESENTA LA MOSTRA
a cura di GIGIOTTO DEL VECCHIO
artisti coinvolti
NADER AHRIMAN .MATTHEW ANTEZZO JONAS MEKAS JONATHAN MONK . JOSEPHINE PRYDE . DAVID WOJNAROWICZ
Cio’ che da sempre caratterizza il processo creativo dell’artista è il suo vissuto, l’esperienza, le visioni, la conoscenza, che può accomodarsi all’interno dell’opera sfruttando più e differenti modalità . Può essere velata allusione, può rimandare attraverso l’atmosfera del lavoro, può esistere quale citazione o riproposizione netta. Ognuna di queste dimensioni racchiude comunque all’interno quella possibilità di scatto assimilativo, percettivo, nella lettura dell’opera che l’appoggiarsi al riferimento inevitabilmente comporta.
Nel caso di Ref. – titolo preso dalla forma abbreviativa di “reference”, elemento esplicativo che incontriamo nella lettura quando ci imbattiamo in una citazione – gli artisti vedono il loro lavoro fortemente caratterizzato dal riferimento, inteso quale omaggio o confronto diretto con la fonte, vero e proprio mito con cui confrontarsi o dialogare. Tutti gli artisti in mostra citano, seppure attraverso modalità e spunti differenti, direttamente. Tutti tranne uno: Jonas Mekas. Il suo è un caso diverso, “di andata e ritorno”, di far riferimento ma anche di essere riferimento.
Nader Ahriman è il pittore della filosofia e dei viaggi nella tradizione metafisica della forma e del pensiero, Jonathan Monk rappresenta l’amore per l’esperienza dell’arte concettuale e dei suoi protagonisti attraverso il ripercorrere idee, momenti, gesti fondamentali citati direttamente (Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Sol LeWitt), David Wojnarowicz attraverso le foto della serie “Arthur Rimbaud in NY” immagina di fare un viaggio con Rimbaud in quei luoghi estremi, periferici, abbandonati propri, forse, del grande poeta francese ma da lui mai conosciuti e che Wojnarowicz, indossando la sua maschera, metaforicamente gli fa conoscere.
Josephine Pryde fa la parodia di Christopher Williams, ma mentre l’artista americano attraverso una fotografia precisa e da catalogo esalta “l’oggetto nobile” attraverso la sua storia ed il suo design (le macchine fotografiche Leika o la “Valentina” della Olivetti, mitica macchina da scrivere), la Pryde attraversa lo stesso processo estetico per esaltare la non nobiltà di un “hi fi car rubato”, mantenendo lo stesso rigore e formale e compositivo.
Con Matthew Antezzo il riferimento si sposta verso la politica e la sua spettacolarizzazione più estetica. Cos’è se non questo il ritratto del subcomandante Marcos? Figura che ha deciso di fare la rivoluzione aggiungendo un tocco di lucida consapevole eleganza alternativa. La scelta di indossare il passamontagna e di non rendere mai visibile il suo volto non è solo dettata dalla necessità di non essere riconosciuto ma diventa sottile elemento di vanità e piacere.
Jonas Mekas si riferisce alla struttura del cinema decostruendola, ma si ritrova nel tempo anche ad essere fondamentale riferimento per un cinema anche ufficiale che riconosce in lui un eccezionale protagonista dell’ironia e della sperimentazione. All’interno di un discorso di fuoriuscita dai canali sotterranei, siamo al principio degli anni “60, in nome di un nuovo cinema americano, si pone la figura di Jonas Mekas, poeta, critico e film-maker lituano, che con il proprio lavoro ed impegno, ha saputo legittimare l’intero pensiero underground, diventandone una delle figure più rappresentative. “Con la partecipazione a Ref. ho inteso accennare al cammino intellettuale e spirituale di questo artista, soffermandomi su quei particolari aspetti registici che lo portano ad essere il massimo rappresentante del genere diaristico” (Gigiotto del Vecchio). Il video in mostra, Lonesome day, è un momento intimo e domestico in cui Mekas si fa riprendere in una esilarante gag danzereccia.
La mostra proseguirà fino al giorno 28 luglio 2007.
La galleria 1/9 unosunove arte contemporanea osserverà i seguenti orari di apertura:
Martedì – Venerdì dalle 10.00 alle 20.00
Sabato dalle 12.00 alle 20.00
Per ulteriori informazioni contattare la galleria:
Tel +39 06 97613696
Fax +39 06 97613810
gallery@unosunove.com
www.unosunove.com
Mer 30 Mag 2007
Salomon Reinach, « La flagellation rituelle »
Posted by Antonio Picariello under ComunicazioneNo Comments
Salomon Reinach, « La flagellation rituelle », Cultes, Mythes et Religions, t. I, Éditions Ernest Leroux, Paris, 1905, pp. 173-183.
La flagellation rituelle [1]
Un des phénomènes les plus significatifs et les plus curieux de la science contemporaine, c’est que l’anthropologie, l’ethnographie et la sociologie sont en train de transformer la philologie classique. Le véritable initiateur de cette révolution fut Mannhardt, qui mourut méconnu en 1880 [2] ; heureusement, il trouva des successeurs, notamment M. Frazer en Angleterre, qui a popularisé la méthode de Mannhardt dans son célèbre ouvrage The Golden Bough, dont le premier volume vient d’être traduit en français. En Allemagne, un philologue de premier ordre, M. Usener, fit appel à l’ethnographie pour élucider les obscurités des institutions antiques [3] et plusieurs de ses élèves, entre autres M. Dieterich [4], sont entrés avec ardeur dans la même voie. L’Angleterre tient toujours la tête, avec des ouvrages comme le Pausanias de M. Frazer, les Questions romaines de Plutarque éditées par M. Jevons, l’Iliade de M. Leaf, dont les amples commentaires sont tout inspirés de la nouvelle méthode. Mais il n’y a plus, en Europe, un seul pays où elle n’ait trouvé des adeptes ; malgré les grimaces de certains vieux philologues, toujours prêts à dédaigner ou à dénigrer ce qu’ils ignorent, on peut dire que le triomphe de l’exégèse ethnographique est d’ores et déjà assuré.
M. A. Thomsen, un jeune savant danois, vient d’apporter une pierre de bonne qualité à l’édifice qui s’élève, en expliquant d’une manière très plausible le rite spartiate de la flagellation des éphèbes, auquel les Anciens eux-mêmes n’avaient rien compris [5].
Tout le monde a entendu parler de cette coutume singulière ; je traduis d’abord les principaux textes antiques qui s’y rapportent.
PLUTARQUE, Lycurgue, 18 : « Les enfants spartiates volent en se cachant avec grand soin ; ainsi l’on raconte que l’un deux, ayant dérobé un petit renard et l’ayant dissimulé sous son manteau, se laissa déchirer le corps par les griffes et les dents de cet animal au point d’en mourir, plutôt que de confesser son larcin. Même aujourd’hui (vers 120 apr. J.-C.), les éphèbes spartiates seraient capables de montrer le même courage, car j’en ai vu beaucoup mourir sous le fouet sur l’autel d’Artémis Orthia. »
PLUTARQUE, Institutions de Lacédémone, 40 : « Les enfants spartiates sont fouettés pendant toute une journée sur l’autel d’Artémis Orthia et souvent ils persistent jusqu’à la mort avec un air de joie et de fierté, rivalisant à qui supportera les coups le plus patiemment et le plus longtemps. Le vainqueur est entouré d’une estime particulière. Ce concours s’appelle “la fouettade†et il a lieu chaque année. »
LUCIEN, Anacharsis, 38 [6] : « Que diras-tu quand tu verras ces mêmes Lacédémoniens battus de verges près de l’autel, tout ruisselants de sang, tandis que les pères et mères, présents à ce spectacle, loin de s’effrayer des souffrances de leurs enfants, les menacent de leur colère s’ils ne résistent aux coups, ou les supplient de supporter la douleur le plus longtemps possible, de s’armer de patience contre les tourments ? On en a vu beaucoup mourir dans ces épreuves, ne voulant pas, tant qu’ils respiraient, demander grâce sous les yeux de leurs parents et céder à la nature. Tu verras les statues que Sparte leur a élevées, honorées d’un culte public… Lycurgue a voulu avoir des citoyens d’une patience à toute épreuve, supérieurs à tous les maux et capables ainsi de sauver la patrie… Un pareil citoyen, s’il est pris à la guerre, ne révélera jamais le secret de Sparte, quelque tourment que lui fassent subir les ennemis ; il s’en rira et, s’offrant à leurs coups, il défiera l’opiniâtreté du bourreau. » Dans le dialogue de Lucien, Solon parle ainsi au sage de la Scythie, Anacharsis ; mais celui-ci ne se laisse pas convaincre et trouve bien ridicule « d’être fouetté tout nu, les bras en l’air, sans qu’il en résulte rien d’utile pour eux ni pour la cité ». « Si jamais, ajoute-t-il, il se trouve à Sparte à l’époque de cette cérémonie, il en rira bien haut, dût-il être lapidé ; toute la ville, à son avis, aurait besoin de quelques grains d’ellébore, puisqu’elle se traite elle-même d’une manière aussi folle. » – C’est Lucien, le Voltaire de l’Antiquité, qui donne son avis par la bouche d’Anacharsis ; il a le mérite de comprendre que l’explication utilitaire de cet usage ne tient pas debout ; mais il ne sait pas reconnaître, parce qu’il a l’esprit voltairien, qu’il y a là -dessous une vieille superstition qui se survit, et non un simple caprice de détraqués.
Les Anciens ont tenté d’expliquer la flagellation spartiate comme une atténuation des sacrifices humains qui étaient prescrits dans le culte d’Artémis chez les Scythes de la Tauride. « Les Lacédémoniens, dit Apollonius de Tyane suivant Philostrate, ont ingénieusement modifié le caractère implacable de ce sacrifice ; ils l’ont remplacé par un concours de courage, où personne n’est tué, mais où l’autel de la déesse n’en est pas moins arrosé de sang [7]. » Retenons cette assertion que les jeunes gens ne succombaient pas sous le fouet ; Plutarque et Lucien ont donc exagéré à plaisir, ou ont généralisé, pour donner du relief à leur récit, un accident isolé.
PAUSANIAS [8], comme Philostrate, identifie cette Artémis Orthia de Sparte à l’Artémis sanguinaire des Scythes : « L’endroit appelé Limnaion (à Sparte) est le sanctuaire d’Artémis Orthia. L’image de bois est, dit-on, celle qu’Oreste et Iphigénie dérobèrent autrefois en Tauride… Un jour que ceux de Limna, de Cynosure, de Mesoa et de Pitane [quartiers de Sparte] sacrifiaient à Artémis, ils se prirent de querelle, se portèrent des coups mortels et tachèrent de sang l’autel de la déesse. Aussitôt une peste terrible se déchaîna. Un oracle, consulté, ordonna que l’autel fût arrosé de sang humain. Le sort tomba sur un homme qui fut immolé ; mais Lycurgue substitua à cet usage celui de fouetter les jeunes garçons, de sorte que l’autel d’Artémis est régulièrement ensanglanté. La prêtresse assiste à la cérémonie, tenant l’image en bois de la déesse. Elle est plate et légère ; mais si les fouetteurs opèrent trop doucement, en raison de la beauté ou de la noblesse d’un des garçons, l’image devient si lourde que la prêtresse peut à peine la soutenir et alors elle dénonce les fouetteurs, disant que leur inertie pèse sur elle. Ainsi le goût du sang humain est resté attaché à cette statue depuis le jour où on lui offrait des victimes en terre taurique. Ils appellent cette image Lygodesrna (c’est-à -dire liée d’osier), ou bien Orthia (debout), parce qu’elle a été découverte dans un buisson d’osier et que les branches enroulées autour d’elle la maintenaient debout. »
Dans un autre passage [9], Pausanias raconte qu’il existe à Aléa, dans le Péloponnèse, un sanctuaire de Dionysos, où, à une certaine fête qui revient tous les deux ans, les femmes sont fouettées, comme les éphèbes spartiates devant la statue d’Orthia. Ce rite se pratique pour obéir à un oracle.
Dans les textes que nous avons cités, il y a deux choses : la constatation d’un usage, qui est un fait historique, et l’hypothèse de l’origine scythique du culte, la flagellation ayant été substituée au sacrifice humain. L’hypothèse n’a aucune valeur, d’abord parce qu’il n’y a pas de traces sérieuses de l’influence des cultes scythiques sur la Grèce, puis et surtout parce que la substitution, ainsi pratiquée, serait absurde. À la place de la victime humaine, on aurait pu fouetter jusqu’au sang un ou deux enfants, choisis parmi ceux qui avaient commis des fautes graves ; on ne conçoit pas qu’on les ait fouettés tous de cette manière, en rendant des honneurs à ceux qui supportaient le plus docilement l’épreuve.
Les Modernes, jusqu’en ces derniers temps, se sont partagés entre deux opinions : les uns ont suivi l’explication de Pausanias et de Philostrate, admettant la substitution de la flagellation à l’immolation ; les autres, beaucoup plus nombreux, ont adopté l’opinion que Lucien met dans la bouche de Solon et ont déclamé – surtout au XVIIIe siècle – sur la vertu des Lacédémoniens la haute estime où ils tenaient le courage physique et le soin qu’ils prenaient d’en entretenir la tradition.
Mannhardt a longuement traité de la flagellation rituelle dans son beau mémoire sur les Lupercales [10]. Comme ce travail n’a jamais été, que je sache, traduit ni même résumé en français [11], je crois utile d’en dégager ici les idées principales, c’est-à -dire de recourir à la source où ont puisé MM. Frazer et Thomsen.
Les Luperques étaient des prêtres romains qui, le 15 février, couraient par la ville, vêtus seulement de peaux de chèvres, et qui frappaient sur le dos et sur les mains, avec des lanières en cuir de chèvre, les femmes qu’ils rencontraient. Cette flagellation, au-devant de laquelle se portaient les Romaines, passait pour les rendre fécondes. La fête comportait d’autres rites de purification, tant des personnes que des choses, sur lesquels il est inutile de nous arrêter [12]. Elle fut supprimée en 496 seulement par le pape Gélase, qui la remplaça par la fête de la Purification de la Vierge (2 février).
Pourquoi les Luperques frappent-ils avec leur lanière (februum), au lieu de se contenter de toucher ? Ici interviennent les faits parallèles que Mannhardt a réunis et fait valoir. Dans le culte secret de Fauna, à Rome, on croyait assurer la fertilité aux femmes en les frappant avec une branche de myrte. Lors d’une fête de Déméter, que nous ne connaissons pas plus exactement, ceux qui la célébraient se frappaient les uns les autres avec des baguettes. À Rome, le 7 juillet, à la fête des nones caprotines, les femmes s’injuriaient et se frappaient, probablement avec des branches de figuier sauvage. Les Arcadiens frappaient l’image de Pan avec des seilles ou oignons marins. En Ionic, à une époque très ancienne, lorsqu’il y avait famine ou pestilence, on commençait par affamer un homme, puis on le conduisait en un lieu consacré, on le bourrait de figues, de fromage, de pain d’orge, enfin on le jetait à terre et, avec une verge composée de scilles, de branches de figuier sauvage et d’autres arbres, on le frappait sept fois sur le membre viril. À Chéronée, du temps de Plutarque, on fouettait un esclave avec des branches d’agnus castus et on le chassait avec ces mots : « Dehors famine ! Entrez, Abondance et Santé ! » Ces rites, qui rappellent celui du bouc émissaire chez les Hébreux, sont évidemment d’origine agricole : ce sont les mauvais esprits, ceux qui nuisent à la fécondité des terres, qui sont chassés, honnis, battus, parfois lapidés et brûlés. Mais Mannhardt a parfaitement reconnu que, dans une phase religieuse antérieure, il ne s’agit pas tant de maltraiter et d’expulser le démon nocif que d’exalter et de fortifier le bon génie de la moisson, représenté par un homme, un animal ou une image, en détruisant, au moyen de coups, les influences pernicieuses qui pèsent sur lui. Ainsi, en Westphalie, le jour de la fête de Saint-Pierre (22 février), les enfants frappent les portes avec des marteaux en criant : « Dehors, l’oiseau de l’été ! » L’oiseau de l’été s’est réfugié pendant l’hiver dans la maison ; il faut l’en faire sortir, comme les Romains faisaient sortir le dieu de la Guerre lorsqu’ils ouvraient les portes du temple de Janus. Nous avons déjà vu que l’on flagellait l’image de Pan en Arcadie ; à Délos, on traitait de même l’image d’Apollon. Évidemment, Pan et Apollon ne sont pas des mauvais génies ; on les frappe, comme les Luperques frappaient les femmes, afin de les rendre féconds et bienfaisants.
Dans les rites agraires de l’Europe, on connaît de nombreux exemples où le « roi de Mai » et d’autres personnifications de la moisson donnent et reçoivent des coups. Mannhardt a étudié, dans un autre ouvrage, une série de coutumes qu’il a réunies sous le nom de Schlag mit der Lebensruthe (fustigation avec la verge de vie) [13]. Au Mardi gras, à Pâques, au 1er mai, à Noël, les hommes et les femmes se battent entre eux ou battent leurs serviteurs et ceux qu’ils rencontrent avec des branches feuillues, des faisceaux de branches ou des lanières de diverses couleurs ; ce sont surtout les filles nubiles et les femmes qui sont ainsi frappées par les hommes, sur les mains, les doigts, les pieds ou le dos. On frappe aussi de même les animaux domestiques et les arbres fruitiers. Souvent, en frappant, on crie : « La maladie au loin ! La santé dans tes membres ! Dehors, le mal ! etc. » Ceux qui frappent, comme les Luperques à Rome, courent à travers les champs, sous des déguisements divers qui ont passé aux fous de cour du Moyen Age, comme la baguette de ceux-ci est devenue la marotte de ceux-là . Charvet, dans son Histoire de la sainte église de Vienne, a décrit un usage, supprimé au XVIIe siècle seulement, dont il a lui-même noté l’analogie avec les Lupercales. Il est vrai qu’il n’y est pas question de coups, sans doute parce que le vieux rite avait été humanisé par l’Église. « On célébrait à Vienne tous les ans, le premier jour de mai, une fête appelée la cérémonie des Noircis… L’archevêque, le chapitre, l’abbé de Saint-Pierre et celui de Saint-André nommaient chacun un homme qui se noircissait tout le corps pour courir les rues dans un état de nudité depuis le matin jusqu’après le dîner, etc. » Le passage est trop long pour être cité ici, mais cette seule phrase suffit à prouver qu’il s’agit d’une course compliquée de mascarade, avec, en outre, la nudité rituelle qui témoigne toujours d’un état de choses très ancien.
Mannhardt n’a pas manqué de se demander, comme le feront sans doute quelques-uns de nos lecteurs, si le rapport établi par ces usages entre la fustigation et la fécondité ne s’expliquerait pas par un ordre de faits physiologiques qui sont du ressort de la psychopathia sexualis. Le savant mythologue a eu raison de repousser cette idée, car les faits en question ne se constatent que dans des civilisations avancées et dissolues ; l’Antiquité même n’en offre guère qu’une seule mention (dans le Satyricon de Pétrone) et il n’en est rien dit dans la littérature moderne avant le XVe siècle, alors que les livres pénitentiaux du Moyen Âge s’en seraient certainement occupés si l’état des moeurs avait appelé sur ce sujet l’attention des directeurs de conscience.
Mais la conclusion adoptée par Mannhardt est certainement à côté de la vérité. Il croit que l’objet de la fustigation est d’éloigner les mauvais esprits, les démons de l’infécondité et de la malvenue. Cela n’explique point la pratique si répandue de fustiger avec les branches de certains arbres, avec des lanières de cuir de certains animaux. M. Frazer, qui a étudié à son tour le problème et allégué des quantités de faits analogues constatés en Afrique, en Asie, en Amérique et en Australie [14], dit avec raison que les flagellations n’ont jamais pour but d’éprouver le courage de la victime, mais de la purifier ; toutefois, il ne tient pas compte non plus, semble-t-il, de l’instrument du supplice, et son explication, n’expliquant pas tous les détails, ne peut être considérée comme adéquate.
Ici se place l’ingénieuse hypothèse de M. Thomsen. C’est avec des baguettes de coudrier que l’on fouette les jeunes Spartiates, et la déesse qui préside à la cérémonie est elle-même la déesse du coudrier (Lygodesma, du grec lygos, coudrier). C’est avec des lanières de cuir de bouc ou de chèvre que les Luperques frappent les Romaines, et la déesse qui préside à la cérémonie, dea Luperca, participe à la fois de la louve et de la chèvre (lupus, hircus). Donc, le but de la flagellation, c’est de faire passer dans le corps du patient la force et la vitalité soit de l’arbre, soit de l’animal, c’est-à -dire sans doute d’un ancien totem. Qu’est cela, sinon une vieille forme de cette idée de la communion, que l’on retrouve un peu partout dans les religions primitives et populaires, depuis qu’on prend la peine de l’y chercher ? La théophagie n’est que la forme la plus répandue et la plus tenace de la communion ; mais la superstition connaît bien d’autres manières d’absorber et de s’assimiler l’énergie d’un arbre, d’un animal, de la terre elle-même, par exemple en passant par la cavité d’un chêne, en revêtant la dépouille d’un loup ou d’un chien, en se couchant à terre (comme les Selles de l’Épire au temps d’Homère, qui couchaient par terre et ne se lavaient jamais les pieds, […] [15]). Donc, le rite spartiate n’est nullement une épreuve d’endurance, ni une atténuation d’un sacrifice humain, mais un rite de communion, un sacrement remontant à l’époque infiniment lointaine où fiorissait le totémisme végétal.
On sait que les usages persistent comme à l’état d’outres vides où le progrès intellectuel et religieux verse périodiquement un vin nouveau. À l’époque d’Hérodote, ou même bien avant, les Spartiates croyaient sans doute de bonne foi qu’ils fouettaient leurs enfants pour leur inspirer le mépris de la souffrance et les endurcir à la douleur. Mais, précisément parce qu’ils croyaient cela, ce ne pouvait être l’explication vraie et primitive, sans quoi l’évolution des idées, contrastant avec la stagnation des rites, serait un vain mot. Aujourd’hui même, nous pouvons constater un changement analogue lors de la première communion des enfants. Le fait même de la communion, de la déglutition de l’hostie consacrée, n’est plus, si l’on peut dire, au premier plan ; ce qui frappe surtout les parents et leurs enfants, c’est le passage de l’enfance à l’adolescence, l’éveil de la responsabilité, que les exhortations du prêtre rendent plus sensibles. L’observation est de M. Samuel Wide et me paraît très juste ; on pourrait d’ailleurs citer d’autres exemples, empruntés aux rites funéraires et matrimoniaux.
L’idée que la flagellation fortifie ou sanctifie ce qui est la même chose paraît s’être réveillée au Moyen Âge, avec tant de conceptions primitives et sauvages que l’étroite aristocratie gréco-romaine avait eu le tort de croire mortes et oubliées. Il ne s’agit pas de la flagellation considérée comme une peine disciplinaire et ordonnée par saint Césaire, en 508, contre les religieuses elles-mêmes ; cela est simplement un emprunt au droit pénal romain. Je parle de la flagellation volontaire, dont les exemples se multiplient depuis le XIe siècle. « Celui qui s’est rendu le plus célèbre par les flagellations volontaires, écrivait le théologien gallican Bergier, est saint Dominique l’encuirassé, ainsi nommé d’une chemise de mailles qu’il portait toujours et qu’il n’ôtait que pour se flageller. Sa peau était devenue semblable à celle d’un nègre ; non seulement il voulait expier par là ses propres péchés, mais effacer ceux des autres ; Pierre Damien était son directeur. On croyait alors que vingt psautiers récités, en se donnant la discipline, acquittaient cent ans de pénitence. Cette opinion était assez mal fondée et elle a contribué au relâchement des moeurs. »
Les flagellants croyaient sans doute que la flagellation constituait une expiation ; mais ce n’en est pas moins une idée secondaire, qui recouvre mal un fond plus ancien et plus barbare. Les rois, les papes et l’inquisition de la fin du Moyen Âge ont poursuivi avec acharnement les flagellants, parce qu’ils devinaient un fond d’hérésie dans leurs pratiques. Voici encore une citation de Bergier qui ne laisse aucun doute à cet égard : « Vers l’an 1348, lorsque la peste noire et d’autres calamités eurent désolé l’Europe entière, la fureur des flagellations recommença en Allemagne. Ceux qui en furent saisis s’attroupaient, quittaient leurs demeures, parcouraient les bourgs et les villages, exhortaient tout le monde à se flageller et en donnaient l’exemple. Ils enseignaient que la flagellation avait la même vertu que le baptême et les autres sacrements ; que l’on obtenait par elle la rémission de ses péchés, sans le secours des mérites de Jésus-Christ ; que la loi qu’il avait donnée devait être bientôt abolie et faire place à une nouvelle, qui enjoindrait le baptême du sang, sans lequel aucun chrétien ne pouvait être sauvé… Clément VII condamna cette secte ; les inquisiteurs livrèrent au supplice quelques-uns de ces fanatiques ; les princes d’Allemagne se joignirent aux évêques pour les exterminer ; Gerson écrivit contre eux, et le roi Philippe de Valois empêcha qu’ils ne pénétrassent en France [16]. »
Le bon Anacharsis, au dire de Lucien, se contentait de prescrire aux Spartiates quelques grains d’ellébore, pour les guérir de leur folie flagellante ; l’Église du Moyen Âge fit dresser des gibets et allumer des bûchers. Le procédé était expéditif, mais brutal. Cependant, quand on étudie dans son ensemble la conduite de l’Église envers les aberrations religieuses des siècles de fer, on ne peut s’empêcher de rendre justice à son bon sens. Elle conserva jalousement, comme elle le devait, ce qui, dans le christianisme des Pères de l’Église, paraît à la pensée affranchie une survivance plus ou moins voilée de vieilles idées mystiques et sauvages ; mais, ce minimum sauvegardé, elle défendit qu’on y ajoutât. Les mystiques eurent plus à pâtir de ses rigueurs que les infidèles ; elle brûla moins de Juifs que de moines exaltés. C’eût été un singulier abandon de ses principes, après tout bienfaisants et raisonnables, si les apôtres de la flagellation sacramentaire avaient trouvé grâce à ses yeux.
P.-S.
Texte établi par PSYCHANALYSE-PARIS.COM d’après l’article de Salomon Reinach, « La flagellation rituelle », Cultes, Mythes et Religions, t. I, Éditions Ernest Leroux, Paris, 1905, pp. 173-183.
Notes
[1] L’Anthropologie, 1904, p. 47-54.
[2] Voir la biographie de Mannhardt par W. Scherer, en tête des Mythologische Forschungen, Strasbourg, 1884.
[3] Voir, en dernier lieu, le beau mémoire de M. Usener sur l’éphébie attique, dans les Hessische Blätter für Volkskunde (Leipzig, 1902, t. I. p. 195-228).
[4] Voir, dans le même recueil (t. I. p. 169-194), l’exposé général de la méthode ethnographique par M. Dieterich.
[5] Anton Thomsen, Orthia, Copenhague. 1902. Ce travail est en danois ; je le connais par une analyse détaillée en allemand, publiée par M. S. Wide, Berl. Philol. Wochenschrift, 1903, p. 1230.
[6] Trad. Talbot, t. II, p. 214.
[7] Philostrate, Vit. Apoll., VI, 20, 2.
[8] Pausanias, III, 16, l0.
[9] Pausanias. VIII, 23, I.
[10] Mannhardt, Mythol. Forschungen (1884), p. 72 et suiv.
[11] Pas même dans le bon article « Lupercalia » du Dictionnaire des antiquités (par M. Hild).
[12] « Purifier » se disait februare d’où le nom de février que porte le second mois de notre année.
[13] Voir aussi E. Mogk, Germanische Mythologie, p. 19-20.
[14] Frazer, Pausanias, t. III, p. 341 ; The Golden Bough, t. II, p. 149, 213.
[15] Cela est vrai de la superstition de tous les temps. Au XVIIe siècle, la duchesse d’Albe, alarmée de l’état de santé de son fils, fit demander à des moines de Madrid quelques reliques. Elle obtint un doigt de saint Isidore, le fit piler et le fit prendre à son fils, partie en potion, partie en clystére (Louville, Mémoires, t. II, p. 107).
[16] Dictionnaire de théologie, éd. de 1789, t. Ill, p. 448. – Je ne sais pas si ces flagellants du Moyen Âge se servaient de disciplines consacrées, ou préféraient des disciplines d’une certaine matière aux autres ; mais à Madrid, au XVIIe siècle, on voyait des flagellants qui attachaient à leurs disciplines des rubans donnés par leurs maîtresses. Ces dames les regardaient, de leur fenêtre, se meurtrir la chair en pleine rue et les encourageaient à s’écorcher vifs. « Quand ils rencontrent une femme bien faite, ils se frappent d’une certaine manière qui fait ruisseler le sang sur elle ; c’est là une grande honnêteté et la dame reconnaissante les en remercie. » (Mme d’Aulnoy, Lettres d’Espagne, t. I. p. 304.) Nous avons là comme une traduction galante de l’usage spartiate, compliquée de l’idée espagnole du point d’honneur ; mais le fait des rubans attachés à la discipline et des dames cherchant à se faire éclabousser de sang sont des caractères tout à fait archaïques et sauvages, certainement antérieurs au christianisme.
Mer 30 Mag 2007
Mario Serra + Innocente Salvini
Posted by Antonio Picariello under arte/teatro , ComunicazioneNo Comments
Ognuno di noi ha un proprio cammino fatto di conoscenza di vita vissuta.
Cerco in ogni istante la vita per trovarne la forma. Viceversa troverei solo il “nulla”.
Questo ed altri piccoli scritti del mio diario ne sono la testimonianza.
A venti anni emigro. Milano; non so nemmeno io il perché. Cercavo lavoro come disegnatore di mobili ed arredatore di negozi, cominciai a mettere inserzioni sui giornali, un uomo mi chiamò al telefono dicendomi di presentarmi l’indomani ad un tale indirizzo. Il mattino seguente, con indirizzo alla mano e dopo diversi mezzi di trasporto, mi sono trovato solo, sperduto, senza un’anima viva, contornato da fabbriche invisibili, poiché la nebbia le nascondeva quasi totalmente. Camminai a lungo, finalmente trovato l’indirizzo!
Il luogo triste, una signora sprofondata nella sedia con la sua enorme mole, alzò lo sguardo e con aria infastidita, mi fece sedere; attenda fra qualche minuto arriva il proprietario e le dirà cosa deve fare. Qualche minuto? Ho aspettato tre ore il suo arrivo. Finalmente! Ha lei è la persona con cui ho parlato al telefono, andiamo nel mio studio. Ecco, noi abbiamo bisogno di un disegnatore per la nostra fabbrica di pentole, ha mai disegnato pentole? Meravigliato gli risposi di no ed incominciai ad elogiarmi delle mie esperienze passate. Bene l’ufficio tecnico e qui: L’ufficio era una stanza di tre metri per tre con solo un tecnigrafo ed una matita. Si sieda e stia li, attenda degli ordini. Guardavo tutto intorno osservando con acutezza qualsiasi cosa, passavano ore ed ore, nessuno! Nessuno in vista, pensai, avrà chiuso la fabbrica. Così passò tutta la giornata senza aver visto nessuno. Il mattino seguente stessa storia, tutto il giorno seduto. Uscii di corsa urlando ed imprecando ” matto io o matti voi!” Questo è stato il primo impatto con la città di Milano.
A quei tempi non pensavo minimamente alla pittura.
Passò qualche anno lavorando in una fabbrica d’arredamenti per negozi.
Un giorno d’inverno andai alla “Permanente di Milano†c’era l’esposizione dei cento pittori Milanesi, ove esponeva anche un mio carissimo amico, Antonio D’Attellis. La mostra non mi piacque molto. Andai al piano superiore non sapendo cosa trovare. Entrai in un enorme salone tappezzato d’enormi quadri. Rimasi incantato da quella pittura di un’energia straordinaria, dai colori possenti ed essenziali, tonalità di rossi, gialli, verdi e qualche sporadica ombra d’azzurro. Divoravo tutto ciò che era dipinto, osservando con attenzione ogni minima luce, ogni colore, più osservavo più mi emozionavo, anzi un inspiegabile eccitamento mi pervase. Per diversi giorni consecutivi ho rivisto quei quadri. Alla mostra incontrai un uomo di piccola statura, con un cappellaccio enorme sulla testa,sorridente. Si avvicinò e mi chiese: cosa mi dice di questa pittura, gli risposi con entusiasmo che ero incantato, disse: questi quadri li ho dipinti io; (era la prima volta che incontravo un pittore), gli comunicai tutte le mie impressioni, le emozioni, la chiarezza con cui ho colto il messaggio di quei quadri; sei un pittore mi disse, gli risposi no non ho mai dipinto, tu sei un pittore, dentro di te c’è la pittura. Contento di questa affermazione iniziai a fargli mille domande, “ mi spigò tutto della sua pittura, come stemperava i suoi colori, come osservava le luci, come il suo lavoro di riflessione era lento ma continuo. Si fermò vicino ad un quadro di paesaggio, tutto rosso, con un cielo stupendo, nuvoloso e con un paese all’orizzonte, disse: ti piace questo cielo? Certo è splendido, replica: peccato che non mi riesce più di saperlo dipingere, rimasi interdetto dalla sua risposta, allora non capivo cosa volesse dire.
Da quel giorno frequentai spesso il suo studio situato all’interno della sua casa paterna con affiancato un mulino. Lo vedevo dipingere rigorosamente dal vero le sue enormi tele legate ad un albero con uno straccio di stoffa. I rossi magicamente diventavano luce, ombra e penombra, che emozione!
Dopo quest’esperienza, durata qualche anno; ho iniziato a dipingere.
Quel pittore era Innocente Salvini. (dal diario di Mario Serra)
Innocente Salvini, nell’ambito della pittura del ‘900 italiano è considerato uno degli artisti più originali, moderni ed europei, e di lui si sono occupati critici come Sebastiano Graso, Alberico Sala, Giovanni Testori e Raffaele De Grada.
Le sue opere sono esposte in prestigiosi musei quali la Collezione d’Arte Religiosa Moderna dei Musei Vaticani, il Civico Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, la Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate ed il Museo Civico di Villa Mirabella di Varese, oltre che in diverse chiese e palazzi pubblici del varesotto.
Ha esposto alla XXV Biennale Internazionale di Venezia e la Società delle Belle Arti e Permanente di Milano ha accolto per ben due volte, la seconda postuma, sue esposizioni personali.
I quadri del Salvini sono intrisi di forti sentimenti verso la terra, la famiglia e la vita quotidiana, verso il suo mulino; i colori sono l’effetto di un lungo studio che lo porta ad un particolare esito cromatico che unisce la tecnica dei Macchiaioli coi principi del Divisionismo di Previati:, il colore come novità scottante, il colore al servizio della luce, il colore interno ai colori naturali, che li segue e li muta. L’esito è quello di opere dove il mondo della realtà è nettamente diversificato da quello della tavolozza, e allora sulla tela il mondo viene ricreato come attraverso uno spettro dove la luce si scompone totalizzando la scala cromatica e annullando bianchi e neri. Salvini era nato tardi per appartenere a certe avanguardie europee, presto per legarsi a quelle nuove del novecento, così la sua pittura resterà sempre al di fuori di scuole e movimenti, in una patria solo sua, distanziata da qualunque altro “realismo” italiano dell’epoca. A causa di questa sua “rottura degli schemi” la sua consacrazione tardò ad arrivare; solo nel 1950 delle sue opere erano presenti alla XXV Biennale di Venezia e nel 1966 Monsignor Macchi, segretario di Paolo VI, acquistò delle sue tele per la collezione d’arte contemporanea dei Musei del Vaticano. Sempre in questi anni realizzò ad Arcumeggia e a Laveno alcuni affreschi; negli anni settanta a Varese e a Milano gli furono dedicate importanti mostre e anche dopo la sua morte (gennaio 1979) numerosi sono stati i momenti di riconoscimento della sua arte (per es. un video documento è stato proiettato alla Permanente di Milano nel 1992).
Annesso all’antico mulino il Museo Salvini è dotato di una galleria utilizzata per esposizioni e manifestazioni artistiche e culturali.
La Galleria è composta da una grande sala e da 2 salette attigue.
Gentilissimo Antonio, grazie per aver ascoltato le mie parole. Innocente Salvini mi ha insegnato innanzitutto la coscienza di un artista, il duro lavoro ed un cammino personale. Ho passato con lui, anche se saltuariamente, dei momenti d’alta poesia. Persona molto disponibile, sempre sorridente, semplice e complessa nello stesso tempo. Mi ha insegnato di andare per musei “ingerire il più possibile quello che interessa, poi uscire e dimenticarsi di tutto. “Quello che serve è già dentro di noiâ€. Parole sue. Caso ha voluto che anni dopo esponessi le mie pitture nella stessa sala della permanente dove sono stati i suoi lavori.
Grazie nuovamente, per la foto della casa d’Innocente dove si vede un pianoforte che personalmente tanti anni fa ho accordato e suonato.
Non ho avuto occasione di visitare il museo, (luogo a me familiare). Ricordo con intensità l’aia dove “pascolavano” i maiali, il ruscello che in alcuni tratti si perdeva in mille rivoli, lì per la prima volta ho disegnato , lo ricordo ancora come se fosse ieri; disegnai il paese di Gemonio . Ho molti bei ricordi di quel luogo.
Mario
Mer 30 Mag 2007
giuseppe siano alla biennale di venezia
Posted by Antonio Picariello under arte/teatro , ComunicazioneNo Comments
Mar 29 Mag 2007
SOMEONE IS WATCHING YOU FROM ON HIGH Gianni Pedullà a Roma
Posted by Antonio Picariello under arte/teatro , ComunicazioneNo Comments
COMUNICATO STAMPA pedullà .doc
COMUNICATO STAMPA
SOMEONE IS WATCHING YOU FROM ON HIGH
The magnetism of the angels’ science
di Gianni PedullÃ
testo scritto di Antonio Picariello
Galleria Pettinato arte contemporanea – Roma
Dal 1 giugno al 21 giugno 2007
Inaugurazione venerdì 1 giugno 2007 ore 18.30
Alla Galleria Pettinato Arte Contemporanea, Via della Lungaretta, 12 – Roma,
si inaugura venerdì 1 giugno 2007 alle ore 18.30 la personale
“SOMEONE IS WATCHING YOU FROM ON HIGH
The magnetism of the angels’ science”
che presenta sino al 21 giugno 2007 le opere di Gianni PedullÃ
testo scritto di Antonio Picariello.
QUALCUNO TI OSSERVA DALL’ALTO
Il magnetismo degli angeli di scienza
Antonio PICARIELLO
“Una volta che si era recato a casa di un maestro di musica suo paziente, Sacks, estratto dalla borsa lo spartito di Dichterliebe di Schumann, lo accompagnò al pianoforte mentre cantava: fintanto che s’impegnava nella musica, la mente disturbata dell’uomo ritrovava ordine e coerenza. In un’epoca di consulti specialistici da due minuti, queste storie hanno un evidente fascino umano”.
Non c’è dubbio che viviamo un tempo in fermento. L’arte si nutre di se stessa, si autofagocita e in questa sua cinetica forma di sopravvivenza, cerca inevitabilmente il cuore di verità che le dia nome e identità . Il caos, nel periodo del post-umano, non gode più di strutture affidabili e di timori che rimandino alla sospensione dell’ordine. L’ espressività artistica oltre-concettuale, adesso chiede autoapprovazione esistenziale a se stessa e si risponde con la voce delle opere che l’artista rimette alla sostanza del mondo. Così la voce solista di Gianni Pedullà , come in un’opera di Sacks che ha trasformato il racconto del caso clinico, rimette sulla tela lo sguardo della dignità dell’altrove. L’opera di Pedullà gode, per propria fattura naturale, di un privilegio fausto che veicola con l’immagine che appare sul supporto, tela e altro, anche una sorta di aureola benigna descritta a suo tempo lucidamente da Benjamin. Le opere di Gianni Pedullà , quindi, sono buone conduttrici di buona magia, entro cui il feticcio e la memoria corrispondono al grado benefico dello sguardo che gli si rivolge. E così tra 20 quadri e 5 sculture Appaiono come angeli evanescenti le “figure umane e sagome di animali; elefanti, pesci palla, ippopotami, sospesi nello spazio e nel tempo, che guardano nel cielo aspettando il da farsi, nell’attesa che accada qualcosa”. Appaiono sottoforma di energia magnetica, la stessa che in qualche modo mette a disposizione delle nostre riflessioni, ancora umane, il pensiero di Schopenhauer, attraverso il Magnetismo animale e la magia. Il tema, anche nel titolo, sprona interrogazioni millenarie : “Siamo soli? Il nostro vivere è scrutato da qualcosa e da altro, siamo inermi ad aspettare corpi desiderosi di partire, desiderosi di capire, di essere persi nel cosmo” . Lo stesso Pedullà per autobiografia e memoria di infanzia, riesce a rispondere ai quesiti che pone con questa mostra. L’apparizione di una figura magica, una madonna calabrese che incontra lo sguardo di tre fratelli incantati e ipnotizzati ritornerà spesso nel linguaggio artistico che Gianni Pedullà ha scelto come voce narrante per ciò e per cui di solito “non si può parlare”. Dove la parola stessa potrebbe occludere nella sua mera significazione fatta di codici comuni, il trasporto sincero dell’alone magico-mitologico e visivo cristiano che di solito chiamiamo fede. È nel fraintendimento dell’immaginazione che qui, invece, nell’opera e nelle opere di Pedullà , il senso esatto si scambia con la rivelazione naturale e con tutta la compiutezza del carico veritiero che il segno e “l’immagine apparita” mettono a disposizione degli iridi anatomici. Qui l’arte apparentemente figurativa dell’artista recupera con leggerezza visiva quanto lo stesso Sacks utilizza con le parole. Ed è con queste che mi preme chiudere questo discorso che autonomamente si regge anche nel vortice nel caos ordinato del nostro accelerato periodo storico.
“Tradizionalmente, l’obiettivo dell’anamnesi è quello di pervenire a una diagnosi. Per Sacks, al contrario, la questione della diagnosi è quasi al limite della non pertinenza, configurandosi più come un preambolo o una riflessione a posteriori. Poiché molti degli stati di cui parla sono incurabili, la forza motrice che anima i suoi racconti non è tanto la corsa alla ricerca di un rimedio, quanto la lotta ingaggiata dal paziente per conservare la propria identità in un mondo completamente alterato dalla malattia. Nei casi clinici descritti da Sacks, l’eroe non è né il medico né la medicina. Suoi eroi sono invece i pazienti che hanno imparato, nel caos della propria mente disturbata, a fare appello a capacità innate di sviluppo e adattamento”. Quello che per la scienza diventa metodo analitico per l’arte, è qui il respiro divino dell’arte si ascolta e si vede, diventa diffusione del senso come sguardi di angeli che sorreggono altri sguardi impossibili da poter guardare negli occhi dalla profondità della superficie terrestre e che, per amore, si configurano nel silenzio parlante di queste opere presenti nella città eterna.
Per informazioni:
Galleria Pettinato Arte Contemporanea
Via della lungaretta, 12 – Roma
Tel. 06-5880904
Mar 29 Mag 2007

Critique : toujours éminent. Est censé tout connaitre, tout savoir, avoir tout lu, avoir tout vu.
Quand il vous déplait, l’appeler Aristarque, ou eunuque.
Flaubert, Dictionnaire des idées reçues.
Edito
L’Aica-France, section française de l’ONG Association Internationale des Critiques d’art (AICA), qui regroupe près de 65 sections et plus de 4000 membres dans le monde, a ouvert son site en Octobre 2004.
Il est accessible à tous, intéressés par la critique d’art à divers titres, tout en réservant certaines pages à ses membres.
On y trouve des informations sur la pratique de la critique d’art et sur l’association elle-même. Il offre des informations sur les conditions porfessionnelles de la pratique de la critique au plan des règles et des usages (principes et questions liées au droit d’auteur, contrats, cessions de droit, conditions de commande, barèmes) et sur les contraintes et obligations tant des commanditaires que des auteurs. Il s’agit d’un chantier de travail dynamique, nourri par des experts mais aussi par les questions et préoccupations des visiteurs, membres ou non.
On y trouve aussi le programme des événements, rencontres et conférences proposés par l’Aica (comme le rendez-vous trimestriel des “Actualités Critiques”) ou susceptibles d’intéresser les membres de l’association comme les visiteurs.
Enfin, il est un espace de réflexion et d’échange sur les enjeux théoriques, méthodologiques, historiques, déontologiques de la critique, et un lieu de référence bibliographique. Il rend compte aussi des publications, débats et recherches en cours.
L’ouverture sur le champ théorique malconnu en France des “cultural studies” est un des premiers axes de réflexion, ouvert avec le séminaire international tenu à Aubervilliers en novembre 2004.
AICA section France
32 rue Yves Toudic, F-75010 PARIS
tel. +33 (0) 01 48 00 00 20
(permanence téléphonique le mardi et le jeudi après-midi)
e-mail : aica-france@aica-france.org
site web : http://www.aica-france.org
newsletter :http://manga.servaux.org/cgi-bin/ma…
Mar 29 Mag 2007
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CRITIQUES D’ART
Posted by Antonio Picariello under arte/teatro , ComunicazioneNo Comments
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CRITIQUES D’ART
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ART CRITICS
Art contemporain et nouveaux usages de la critique institutionnelle
Animée par Stephen Wright, dans le cadre du programme de recherche « Art et mondialisation » de l’INHA
Institut national d’histoire de l’art
Salle Walter Benjamin
2 rue Vivienne
75002 paris
accès : 6 rue des Petits Champs
La revue Multitudes publie un dossier dans son numéro 28 (mars 2007) intitulé « L’extradisciplinaire : vers un renouvellement de la critique institutionnelle », qui s’intéresse à l’émergence d’une « troisième génération » des pratiques artistiques couramment assimilées à la « critique institutionnelle ». Depuis deux ans, on constate un intérêt accru pour les tenants et aboutissants de cette mouvance : des articles importants ainsi que plusieurs ouvrages et dossiers de revues lui ont été consacrés.
Dans les années 1960 et 1970, des artistes tels que Marcel Broodthaers, Hans Haacke et Daniel Buren se sont efforcés de critiquer l’institution muséale depuis l’intérieur, mettant à ses normes tacites et ses formes de coercition cachées. Une deuxième génération, marquée à partir de la fin des années 1980 par des artistes comme Renée Green ou Andrea Fraser, poursuit cette investigation des conditions muséologiques de la représentation. Mais à la critique des institutions s’est substituée une certaine « institutionnalisation de la critique ». Depuis quelques années, une troisième génération semble plutôt soucieuse de s’arracher à toute discipline constituée, mobilisant les outils de l’art pour critiquer d’autres institutions, loin du champ de l’art.
« Quel est la logique, le besoin ou le désir qui pousse de plus en plus d’artistes à s’aventurer en dehors de leur propre discipline, définie par les genres traditionnels de la peinture et de la sculpture, ou par les notions philosophiques de réflexivité libre et d’esthétique pure ? » (Brian Holmes). Quel est ce « dehors » recherché, sinon celui, tout près, qui nous sépare des forces qui créent le temps présent ? Ce sont toutes ces questions qui seront abordées lors de cette rencontre.
Avec : Ursula BIEMANN (vidéaste), Brian HOLMES (critique d’art et coordinateur de Multitudes, 28), Angela MELITOPOULOS (vidéaste), Claire PENTECOST (artiste), Suely ROLNIK (psychanalyste)
14h
Présentation de la journée d’études, Logique, enjeux et pièges de la critique institutionnelle
par Stephen Wright, pensionnaire à l’INHA
14h30
L’extradisciplinaire : vers un renouvellement de la critique institutionnelle
par Brian Holmes, critique d’art et coordinateur de Multitudes, 28
15h00
Présentation et projection de Black Sea Files
par Ursula Biemann, artiste, enseigne à l’Esba de Genève et à l’HGK de Zurich
pause
16h30
L’art c’est la vie : artiste-chercheur et biotech
par Claire Pentecost, artiste, professeur au Art Institut of Chicago
17h00
La mémoire du corps contamine le musée
par Suely Rolnik, psychanalyste, professeur et coordinatrice du programme de doctorat « Subjectivité contemporaine » à l’Université de Sao Paulo
17h30
Présentation et projection de Corridor X
par Angela Melitopoulos, artiste vidéaste
Pierre Restany et les influences littéraires de son activité critique : des poèmes-objets au Nouveau Réalisme.
conférence donnée par Massimiliano de Serio, boursier San Paolo-INHA
L’intérêt de Pierre Restany (1930-2003) pour la poésie imprègne son parcours critique entier et amène le critique à concevoir la possibilité d’être poète et de se dédier entièrement à la poésie. Cet intérêt marque aussi le début de son activité dans le monde de l’art, sous le nom de « poèmes-objets », vus comme champs d’expérimentation et d’échange avec les artistes.
Cette conférence permettra de relire le chemin critique de Restany de ses débuts jusqu’aux années du Nouveau Réalisme, en mettant en relief les occasions de rencontre et les affinités entre activité critique de Restany et mouvements et expériences littéraires de l’époque, de la poésie de Francis Ponge aux théories du Nouveau Roman de Robbe-Grillet.
Massimiliano De Serio, après une maîtrise sur le critique Pierre Restany et un master sur “Les systèmes et les professions autour des musées d’art contemporain†à l’Université de Turin, soutient à une thèse de doctorat sur Développement des théories de Pierre Restany dans l’art et la critique d’art des vingt dernières années, entre France et Italie, à l’Université de Paris VIII. Il effectue pour l’instant en France des recherches sur Pierre Restany comme boursier Fondazione per l’arte della Compagnia San Paolo-INHA pour un an, d’avril 2005 à mars 2006.
Il est aussi réalisateur et ses films ont été primés dans plusieurs festivals internationaux ainsi que à des expositions d’art contemporain (T1, la Syndrome de Pantagruel). Ils seront présentés le mardi 14 mars, à 18h, salle Giorgio Vasari.
Accueil / Agenda / Archives
Les archives Roger Marx (1859-1913) et Claude Roger-Marx (1888-1977), de nouvelles sources pour l’étude de la critique et de l’histoire de l’art en France
Catherine MENEUX, doctorante en histoire de l’art,
Georges FRECHET, conservateur en chef à la bibliothèque de l’INHA
Alors que l’inventaire des archives Claude Roger-Marx a été achevé récemment, cette rencontre se propose de présenter l’ensemble des fonds relatifs à deux générations de critiques et d’historiens de l’art : Roger Marx et Claude Roger-Marx. Ces fonds se répartissent dans trois séries d’archives : il y a d’abord un ensemble composite de documents sur l’œuvre et la carrière de Roger Marx, qui ont fait l’objet d’un inventaire en 1999 par Natacha Villeroy-Blondeau. En second lieu, une centaine de cartons renferment l’ensemble des archives de Claude Roger-Marx, données par ses petits-enfants ; enfin, la bibliothèque de l’INHA a acquis en 2004 la correspondance de Roger Marx conservée par ses descendants, ainsi qu’une collection importante d’autographes d’artistes du XIXe siècle (Delacroix, Ingres, Gauguin, Millet…), constituée par Claude Roger-Marx. La présentation de ces fonds d’archives permettra de mettre en évidence les parcours distincts d’un père et d’un fils, qui ont été tous deux critiques d’art, historiens et fonctionnaires. L’évocation du contenu et de la taxinomie de chaque fonds renverra alternativement à l’image privée ou publique de ces deux hommes, à leurs conceptions différenciées de l’exercice de la critique, à leur rapport à l’histoire, ainsi qu’à des champs plus ou moins étudiés de l’histoire de l’art aux XIXe et XXe siècles.
– Catherine Méneux achève une thèse pour le doctorat en histoire de l’art contemporain sur « Roger Marx (1859-1913), critique d’art » à l’université de Paris IV, sous la direction de Bruno Foucart. Elle a réalisé l’inventaire des archives Claude Roger-Marx en 2003-2004, ainsi que l’inventaire du fonds d’autographes des collections Roger Marx et Claude Roger-Marx. Ses recherches s’articulent autour des problématiques liées à la réception, aux sociétés d’artistes, ainsi qu’à l’histoire des arts graphiques. Elle a notamment publié : « De l’art et de la littérature. Roger Marx et Edmond de Goncourt » dans le Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français (2003). Après plusieurs autres exposition, en tant que commissaire scientifique, elle prépare une exposition sur « Roger Marx et l’art de son temps », qui aura lieu au musée des beaux-arts de Nancy en 2006, en partenariat avec le musée d’Orsay.
– Georges Fréchet est conservateur en chef à la Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet. Il est responsable du signalement des fonds du service du patrimoine et dirige la rédaction des instruments de recherche sur les fonds spéciaux. Chartiste et historien d’art, il s’intéresse aux sources de l’histoire de l’art en tant qu’instrument vivant d’une recherche interdisciplinaire. Il a été commissaire général ou collaborateur de dix-huit expositions. Ses publications concernent majoritairement l’histoire du livre, la gravure, l’architecture, la prosopographie et l’iconographie.
Lun 28 Mag 2007
serie dipinta nel lontano 1988 dal titolo “il mio funerale”Mario Serra
Posted by Antonio Picariello under arte/teatro , ComunicazioneNo Comments
mi fa piacere che veri artisti rimettono antiche ricerche che hanno valore documentativo e di riprova che in fin dei conti molta arte di adesso spacciata per innovazione non è altro che revival, così ci rendiamo conto che siamo infestati da false avanguardie e vere retroguardie. Incredibile la furbizia del mercato….
Gio 24 Mag 2007